Paix et sécurité | Vers un monde plus stable
15 janvier 2009
La politique africaine du président Bush a reposé sur le partenariat
Propos de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Mme Jendayi Frazer
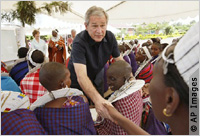
Washington - Le partenariat a été l'élément dominant de la politique du gouvernement Bush en Afrique subsaharienne, a indiqué la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Mme Jendayi Frazer.
Au cours des huit dernières années, cette politique a reposé sur des fondements très solides de partenariat qui ont contribué à améliorer la santé et la vie des Africains à de nombreux égards.
Mme Frazer a souligné ce point lors de l'entretien qu'elle a accordé le 14 janvier à America.gov, quelques jours avant que le président Bush, ses ministres et de nombreux hauts responsables, dont Mme Frazer, quittent leurs fonctions pour laisser la place au nouveau gouvernement le 20 janvier, après la prestation de serment du président Barack Obama.
« Lorsque nous parlons de partenariat, a-t-elle dit, nous voulons dire que nous respectons le point de vue des Africains et que nous croyons qu'ils peuvent réaliser de grands objectifs. »
Paraphrasant le président Bush, elle a ajouté : « Nous n'allons pas le faire pour eux, mais nous le ferons avec eux. (…) Nous ne pouvons pas remplacer l'esprit d'initiative des Africains, mais nous pouvons le faciliter et le soutenir (…) Le partenariat consiste à aider les autres à agir pour eux-mêmes (…) et à respecter leur point de vue. »
Pour illustrer ce point, Mme Frazer a fait état de la situation actuelle en Somalie. L'Union africaine, le gouvernement fédéral de transition et l'opposition en Somalie ainsi que les pays qui ont détaché des soldats auprès de la force de l'Union africaine ont tous demandé à l'ONU de prendre le contrôle de l'opération de maintien de la paix dans ce pays. « Les États-Unis, a-t-elle dit, ont pris sérieusement en considération leur appel et incitent le Conseil de sécurité de l'ONU à lancer une opération de maintien de la paix en Somalie parce qu'ils tiennent compte de ce que les Africains disent. D'autres pays n'ont pas fait de même. »
Dans le cadre de ce partenariat avec l'Afrique, a expliqué Mme Frazer, les États-Unis ont fait tout leur possible pour encourager la démocratisation, la paix, la prospérité et l'amélioration de la santé publique au moyen d'une multitude de programmes novateurs et d'un dialogue intense avec les Africains.
Cette politique semble avoir donné de bons résultats, a-t-elle dit en indiquant que le taux de croissance du produit intérieur brut des pays subsahariens était de 6 % en moyenne. Certains pays connaissent à l'heure actuelle un taux élevé de croissance, notamment l'Angola (27 %) et le Mozambique (10 %). Seul le Zimbabwé a un taux de croissance négatif.
Ancienne ambassadrice des États-Unis en Afrique du Sud, Mme Frazer, qui a également été à la tête de la direction des affaires africaines au sein du Conseil de la sécurité nationale de 2001 à 2004, a fait remarquer que le plus grand obstacle à la démocratie en Afrique provenait de chefs d'État, comme le président du Zimbabwé, M. Robert Mugabe, qui refusaient de céder le pouvoir. En Guinée, le président Lansana Conté, qui est décédé récemment, « est resté si longtemps au pouvoir qu'à sa mort les institutions politiques étaient devenues trop faibles et que l'armée est intervenue ».
C'est pour cette raison, a-t-elle dit, que les dirigeants africains doivent faire en sorte que la passation des pouvoirs se fasse dans le calme et dans l'ordre conformément à la volonté des électeurs de leurs pays respectifs.
La société civile constitue, selon elle, « le fondement des progrès réalisés en matière de démocratie en Afrique ». Le gouvernement Bush a œuvré avec des organismes africains en vue de la cessation des conflits en Sierra Leone, au Libéria, en Angola, au Burundi, au Congo et au Soudan. « Tous ces pays étaient en proie à un conflit d'un grand ampleur », lors du premier mandat du président Bush.
« Il est évident que la Somalie était l'État défaillant qu'elle est encore de nos jours, mais nous avons fait de grands progrès sur le plan du règlement des conflits. »
On observe cependant un certain retour en arrière dans l'est du Congo, où des milices prolifèrent malgré les efforts diplomatiques intenses qui ont lieu à l'heure actuelle. Il en est de même au Soudan, où les problèmes persistent au Darfour alors que l'Accord Nord-Sud est entré en vigueur.
Le gouvernement Bush a joué un rôle actif pour tenter de faciliter le règlement du conflit au Darfour. Il a consacré près de 5 milliards de dollars au titre de l'aide à cette province du Soudan depuis 2004, et 100 millions de dollars à la formation des soldats qui participent au maintien de la paix.
Dans le domaine économique, les pays africains ont tiré de grands avantages du Compte du millénaire créé par le président Bush et dont la mission est de favoriser la croissance économique et la bonne gouvernance dans divers pays en développement.
De même, l'AGOA (loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique), qui permet l'entrée en franchise de douane de produits africains aux États-Unis, et l'OPIC (l'organisme fédéral de promotion des investissements privés à l'étranger), qui garantit les investissements directs du secteur privé des États-Unis dans les pays en développement, dont les pays africains, ont permis à ces pays d'obtenir de bons résultats.
Toutefois, c'est dans le domaine de la santé que l'action du gouvernement Bush en Afrique restera la plus mémorable. Il s'agit notamment du plan d'aide d'urgence du président à la lutte contre le sida à l'étranger (PEPFAR), qui vient d'être prorogé pour une période de cinq ans et dont la nouvelle dotation est de 30 milliards de dollars, ainsi que de l'Initiative en faveur de la lutte contre le paludisme (1,2 milliard de dollars) lancée en juin 2005 pour combattre cette maladie durant une période de cinq ans dans les 15 pays africains les plus touchés.
